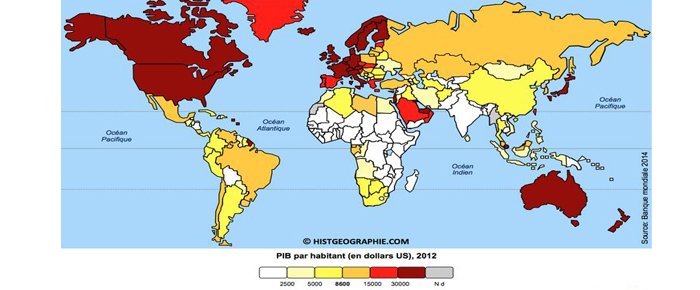
Ce que l'on nomme le PIB, ou produit intérieur brut, est un indicateur du volume de production d'une économie. Il se définit en première approche comme la somme des valeurs monétaires des biens et services de consommation finale produits dans un espace géographique donné au cours d'une période fixée.
Mathématiquement, on va noter
où les quantités pi et qi représentent respectivement les prix de vente et les quantités produites des biens de type i de consommation finale, c'est-à-dire des biens destinés à être acquis par un consommateur privé (pain, téléviseur à usage privé…). Les biens acquis à usage professionnel, appelés biens intermédiaires, ne sont pas comptabilisés (camionnette de livraison, ordinateur à usage professionnel…).
Pourquoi ne retenir que les biens de consommation finale ? Un exemple simple permet de répondre. Considérons la fabrication d'une table. Un menuisier achète des planches (produites et vendues par une scierie). Il transforme ces planches en tables, qu'il revend. Le prix de vente du menuisier va évidemment comprendre à la fois le prix d'achat des planches et sa marge bénéficiaire. Le prix des planches vendues par la scierie est donc inclus dans le prix de vente des tables produites.
Si cette identification entre biens de consommation finale et biens intermédiaires est parfois évidente (un sandwich vendu par un traiteur ; un four industriel…), elle est parfois plus délicate. Voyons ce qu'il en est de la fabrication d'une voiture ; le même véhicule acquis par un enseignant sera un bien de consommation finale, alors que, acquis par une société (pour prospecter des clients), il interviendra dans le coût de production. Et que dire d'un véhicule acquis par un indépendant, affecté cinq jours semaine à l'usage professionnel, et deux jours à l'usage privé ? Il faut donc modifier et adapter la première définition.
Les fruits de la valeur ajoutée
On peut aussi définir le PIB comme la somme des valeurs ajoutées VA (différence entre le prix de vente et le prix d'achat) des unités économiques résidentes (entreprises actives sur le territoire).
La formule mathématique transformée devient
où l'indice i parcourt toutes les entreprises résidentes. Les deux définitions conduisent au même résultat, comme l'illustre l'exemple suivant, schématisant la production d'une voiture :
|
Valeur des achats |
Valeur des ventes |
VA |
|
|
Extraction minerai et pétrole |
0 | 150 | 150 |
|
Transformation en tôles et plastiques |
150 | 250 | 100 |
|
Assemblage en usine |
250 | 450 | 200 |
|
Distribution aux consommateurs |
450 | 600 | 150 |
| 600 |
La valeur de la consommation finale (prix de vente de la voiture) vaut bien évidemment le même montant que la somme des valeurs ajoutées à chacune des quatre étapes du processus de production. À chaque étape, une valeur ajoutée est générée. Les fruits de cette valeur ajoutée sont redistribués aux agents économiques, sous forme d'intérêts, de salaires, de loyers, de dividendes. La seconde approche du produit national regroupe ces revenus. En comptabilité nationale, le revenu ainsi déterminé est un revenu brut, et ne tient donc compte ni des impôts qui frappent ces revenus, ni des transferts sociaux reçus par les ménages. Lorsque l'on tient compte de ces aspects, on détermine alors le revenu disponible Ydisp = Ybrut – prélèvements + transferts.
Toute la production nationale étant écoulée, la mesure de la dépense totale va conduire au même résultat que les deux obtenus précédemment. On distingue quatre types de dépenses, d'utilisation de la production nationale : la consommation privée des ménages (C), l'investissement (I) des entreprises, de l'État et des ménages, les dépenses courantes des pouvoirs publics (G) et les exportations nettes, exportations moins importations (X – M). Le PIB se ventile alors en Y = C + I + G + (X – M). Il faut aussi prendre en considération les secteurs non marchands.
Dans quelle mesure interviennent-ils dans nos définitions ? Les services fournis par les écoles, les hôpitaux, les pouvoirs publics (police, transports, recherche…) ne génèrent pas de valeur ajoutée au sens comptable du terme. En comptabilité nationale, on leur affecte une valeur ajoutée égale à leur coût de fonctionnement.
Un autre paramètre à prendre en considération est le taux d'inflation, qui peut être mesuré au moyen de l'indice des prix à la consommation (IPC). On distingue souvent le PIB à prix courants (ou PIB nominal) et le PIB à prix constants (ou PIB réel). Considérons ainsi une économie qui ne produit qu'un seul bien :
| 2015 | 2016 | |
| Prix | 20 | 22 |
| Quantité | 50 | 50 |
| PIB | 1 000 | 1 100 |
Alors que le PIB est censé mesurer la quantité produite, le simple effet-prix entraîne une hausse du PIB de 10 %, alors que la production réelle de l'économie est inchangée. Le PIB nominal est donc un piètre outil de mesure. La solution adoptée consiste à bloquer les prix à leur niveau de référence. Ici, on aménage les données en postulant que les prix sont restés inchangés :
| 2015 | 2016 | |
| Prix | 20 | 20 |
| Quantité | 50 | 50 |
| PIB | 1 000 | 1 100 |
Le PIB en termes réels demeure inchangé. En pratique, on doit utiliser un indicateur, comme le taux d'inflation, qui permet la reconstitution du PIB réel à partir du PIB nominal. En première approximation, on peut se contenter de retenir : croissance + inflation = évolution du PIB nominal.
La croissance économique
Lorsque le PIB réel d'une économie subit une hausse durable, on parle de croissance de l'économie. Cette croissance peut s'expliquer par la croissance démographique (par exemple via l'immigration), l'accumulation de capital (investissements durables en infrastructure, construction d'usines…) ou le progrès techniques (cf. l'organisation scientifique du travail chez Ford).
Ainsi, le PIB européen (vingt-huit pays membres, les données économiques datant d'avant le Brexit) est passé entre 2009 et 2013 de 11 816 à 13 069 milliards d'euros (soit une augmentation nominale de 10,6 %). En tenant compte de l'inflation, le taux de croissance du PIB européen, sur cinq ans, n'est plus que de 3,4 %, la différence entre ces deux taux s'expliquant par la hausse des prix.
Lire la suite