
Le 11 Pluviose de l'an III (30 janvier 1795), Joseph-Louis de Lagrange (1736–1813) commence ainsi le cours qu'il délivre aux auditeurs de l'École normale, décrétée trois mois plus tôt par la Convention : « Ce jour est destiné à une conférence sur l'arithmétique. »
À ce public constitué par l'élite des futurs éducateurs de la toute nouvelle République, Lagrange commence par expliquer les avantages du système décimal ; mais happé au passage par les nombres premiers, il cite un théorème qui, dit-il, « n'est d'aucune utilité pour la recherche des nombres premiers, mais qui est très remarquable par sa simplicité et sa généralité ».
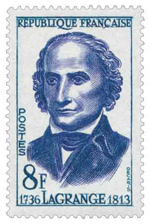 Voici comment il l'a exposé : « Si un nombre est premier, comme 5, le produit de tous les nombres inférieurs, 2, 3, 4, plus l'unité, sera divisible par 5. Si le nombre proposé est 7, alors on fera le produit de 2 par 3 par 4, par 5, par 6, ce qui donne 720 ; ajoutant l'unité, on a 721, divisible par 7. Prenons encore 11, on aura 2 par 3 par 4, par 5, par 6, par 7, par 8, par 9 par 10, égal à 3 268 800 ; ajoutant l'unité, on a 3 628 801, divisible par 11, le quotient étant 329 891.
Voici comment il l'a exposé : « Si un nombre est premier, comme 5, le produit de tous les nombres inférieurs, 2, 3, 4, plus l'unité, sera divisible par 5. Si le nombre proposé est 7, alors on fera le produit de 2 par 3 par 4, par 5, par 6, ce qui donne 720 ; ajoutant l'unité, on a 721, divisible par 7. Prenons encore 11, on aura 2 par 3 par 4, par 5, par 6, par 7, par 8, par 9 par 10, égal à 3 268 800 ; ajoutant l'unité, on a 3 628 801, divisible par 11, le quotient étant 329 891.
Ce théorème est un des plus beaux qu'on ait encore trouvé ; il est surtout remarquable en ce qu'il a toujours lieu lorsque le nombre proposé est premier, et qu'il n'a pas lieu quand le nombre n'est pas premier ; ce qui est aisé à vérifier. » (Mathématiques et Mathématiciens, Pierre Dedron et Jean Itard, Magnard, 1959).
Faire partager une conviction
Est-ce par égard pour un auditoire dont il ne connaît pas le niveau de science que Lagrange, « le premier des savants de l'Europe », propose ses exemples en détaillant « 2 par 3 par 4 par 5 par… », et en spécifiant lieu et non-lieu du théorème ? Toujours est-il que cette sorte d'anaphore portée par la parole est, semble-t-il, portée par le désir de faire partager une conviction.
Près de deux siècles et demi plus tard. Classe de maths, terminale.
Le professeur annonce à ses élèves qu'ils vont avoir à chercher la démonstration du théorème dont il vient d'écrire le texte au tableau :
p est premier ⇔ (p - 1) ! + 1
\( \equiv\) 0 [p].
Et maintenant, rêvons. L'intello de service, Martin, qui, comme ses camarades, sort d'un cours de littérature, lui demande : « Monsieur, vous avez dit “texte” ?
– Oui.
– De qui est-ce ? »
Répondre ne serait pas facile. Première présomption : ce théorème est dit « de Wilson ». Mais dans son Budget of Paradoxes (Dover, 1954), après avoir pourfendu le conte « absurde » selon lequel Pascal aurait réinventé la géométrie dans l'ordre même des propositions d'Euclide, et toujours aussi agacé, Auguste De Morgan (1806–1871) consacre une page à ce Wilson (1741–1793) qui s'est « taillé un nom en théorie des nombres » alors qu'il n'avait pas publié la moindre œuvre mathématique (il deviendra Sir John Wilson et s'éteindra avec une excellente réputation de… juriste). N'empêche. De ce théorème, il aurait eu l'idée. Mais Leibniz aussi… Alors, qui en est l'auteur ?
Dans la notice qu'il consacre à la vie et aux ouvrages de Lagrange, Jean-Baptiste Delambre (1749–1822) cite comme particulièrement remarquable « la démonstration d'un théorème curieux sur les nombres premiers, démonstration que personne n'avait pu trouver et qui était d'autant plus difficile qu'on ne sait comment exprimer algébriquement les propositions de cette espèce » (Œuvres de Lagrange, tome III, Nouveaux Mémoires de l'Académie des sciences et belles lettres de Berlin, année 1971).
Justement, Lagrange a su ; voici ce qu'il en dit lui-même ce 13 juin 1771, face cette fois à ses pairs, à l'Académie de Berlin. « Monsieur Waring fait honneur de ce théorème à Monsieur John Wilson, mais il n'en donne point la démonstration, et il paraît même insinuer que personne ne l'a encore trouvée ; du moins il semble qu'il la regarde comme extrêmement difficile. » « Cette raison, jointe à l'élégance et à l'utilité du théorème dont il s'agit, m'a engagé à chercher une démonstration, et celle que j'ai trouvée m'a paru mériter l'attention des Géomètres […]. » Il commence ainsi : si n est un nombre premier quelconque, le nombre 1×2×3×4×5×… ×(n–1) + 1 sera toujours divisible par n, c'est-à-dire que le produit continuel des nombres 1, 2, 3 jusqu'à n – 1 inclusivement, étant augmenté de l'unité, sera divisible par n, ou bien que si l'on divise ce même produit par n on aura –1, ou, ce qui est la même chose, n – 1 pour reste.
Barbarisme !
« Nous disposons ainsi bien d'un texte, et de l'auteur de sa première démonstration. Satisfait, Martin ? » Sollicité, celui-ci prétend que ce n'est pas le même texte qu'au tableau, et que si en 1771 c'en était un, il aurait eu droit à des traductions, mais non à une compression. Imagine-t-on pour la Recherche du temps perdu le traitement que le temps, tout court, fait subir aux supposés « textes » mathématiques ?
Non, on n'imagine pas. Mais l'éminent sémiologue du XXe siècle Roland Barthes pourrait être requis, selon lequel « tout texte est un intertexte ; d'autres textes sont présents en lui, à des niveaux variables, sous des formes plus ou moins reconnaissables ; les textes de la culture antérieure et ceux de la culture environnante ; tout texte est un tissu nouveau de citations révolues. »
Des citations révolues, Martin ! Puisqu'il n'y a plus lieu pour nous de dire ou d'écrire le « produit continuel jusqu'à n – 1 inclusivement », et encore moins « 2 par 3 par 4 par 5… ». Un mot est apparu en 1796, qui a été inventé pour des raisons de nécessité pratique par un mathématicien alsacien, Louis-Antoine François Arbogast (1759–1803), en tant que produit d'un nombre fini de termes en progression arithmétique : oui, c'est le mot « factorielle ».
Le mot est remplacé par un signe que vos camarades et vous connaissez, maintenant deux fois plutôt qu'une, à savoir « ! », proposé en 1808 par un autre Alsacien, Christian Kramp. Euler avait essayé, par exemple, de remplacer 1×2×3×…×m par M, mais que faire s'il s'agissait de 1×2×3×4×5×6, ou encore de 1×2×3×4×5×…×r ? Une jolie tentative fut proposée par un philosophe et pédagogue allemand, J.B. Basedow : *n pour 1234…n. Il y en eut bien d'autres, mais c'est la notation de Kramp qui devint très vite indispensable, et « ! » s'imposa donc, déclenchant un nouvel agacement chez De Morgan, qui regrette – en 1842 – que parmi bien d'autres « barbarismes », ce signe « ! » donne à des pages sérieuses le sentiment qu'il faudrait « être surpris ou admiratif que s'y trouvent 2, 3, 4, etc ».

Nicolas Bourbaki en 1935.
Poursuivons. Inutile de préciser avec des mots quand ce théorème a lieu et n'a pas lieu, le signe ⇔ inventé par Bourbaki – vous pourrez chercher de qui il s'agit – exprime l'un et l'autre.

Enfin, grâce à Gauss qui, en 1801, introduit sa théorie des congruences, « divisible » devient aussi une citation révolue.
« C'est fini ?
– Non, ce n'est pas fini. Mais peut-être en savez-vous assez pour comprendre comment, en mathématiques, les “textes” s'expriment de façon de plus en plus ramassée, les phrases devenant des mots, ces mots des termes, ces termes des signes, ces signes des formules ; et comment, alors même qu'ils ont perdu les chatoiements de leur langue d'origine, ces termes peuvent conférer une suprême élégance à une démonstration. Voyez-vous, Martin, comme bien d'autres, le “texte” qui est au tableau en est bien un, poli par les innombrables passages de témoin, ces “auteurs” cherchant à transmettre des vérités éternelles, qui… Oui ? Vous vouliez ajouter quelque chose, Martin ?
– Non monsieur ; ou plutôt si : il est l'heure ! »