
Quelle belle surprise de découvrir un jour ensoleillé dans La Presse de Tunis, quotidien en français, une page complète de jeux « vraiment » mathématiques, ou de voir pour la première fois dans les années 2000 une grille de Sudoku, pas encore courant en France, dans le journal suisse Le Temps ! Les jeux mathématiques, qui pourtant pourraient faire aimer les maths à beaucoup de lecteurs, ne sont présents que dans les mensuels estampillés « sciences », mais les hebdomadaires ou les quotidiens « grand public » sont pour beaucoup frileux sur ce point. Seuls quelques-uns osent tenter le pari, souvent avec succès d’ailleurs.
Premiers jeux : pour initiés
Les mathématiciens avaient l’habitude, dès la Renaissance, de se lancer des défis, les proposant même parfois à tous à travers des affiches ou des joutes publiques. La plupart du temps, cependant, les problèmes restent « en vase clos », dans l’entre-soi des mathématiciens, et les échanges sont surtout épistolaires ou publiés sous forme de recueils. Le jeu d’Icosie, imaginé par le mathématicien et astronome irlandais William Rowan Hamilton en 1857 (où il s’agit de trouver la route à emprunter sur les arêtes d’un dodécaèdre régulier en passant une seule fois par tous les sommets), a même été présenté lors d’un congrès de mathématiciens. On a certes commercialisé ce casse-tête en 3D avec une ficelle nouée à l’un des sommets à enrouler pour matérialiser le chemin, il reste que la diffusion de tels jeux est longtemps restée restreinte. La presse pourrait être un bon support de popularisation des mathématiques par le jeu, mais c’est surtout dans la presse scientifique mensuelle que l’on trouve des pages consacrées à ce sport cérébral, comme si ces jeux de l’esprit étaient réservés aux seuls initiés.
L’un des premiers à avoir proposé des problèmes à la presse est James Joseph Sylvester (1814–1897), mathématicien britannique, dont on se rappelle les problèmes qu’il posait régulièrement au journal Educational Times (voir FOCUS "L'un des problèmes de Sylvester"). Que ce soit ceux de Hamilton ou de Sylvester, n’oublions pas que la plupart de ces problèmes sont devenus par la suite de véritables objets d’étude, et ont été largement traités, approfondis et généralisés par des mathématiciens, faisant parfois avancer des domaines scientifiques, comme la théorie des graphes.
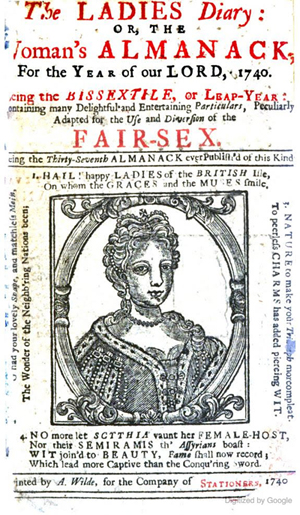 Cependant, même s’il a largement contribué à la popularisation des sciences mathématiques, le journal s’est vite éloigné de ses préoccupations de divertissement du début pour devenir un journal scientifique abordant des sujets de plus en plus élaborés, de manière plus sérieuse que ludique.
Cependant, même s’il a largement contribué à la popularisation des sciences mathématiques, le journal s’est vite éloigné de ses préoccupations de divertissement du début pour devenir un journal scientifique abordant des sujets de plus en plus élaborés, de manière plus sérieuse que ludique.
Un nouvel essor
Les jeux mathématiques avaient fini, au début du XXe siècle, par n’être plus des jeux et ils n’amusaient plus que les spécialistes. C’est à l’Américain Martin Gardner (1914–2010) que l’on doit leur renouveau dans la presse. Déjà connu pour ses ouvrages, dont une version annotée d’Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, c’est par ses chroniques dans la revue Scientific American entre 1957 et 1980 que Martin Gardner a non seulement fait connaître des pans entiers de mathématiques, mais a largement débordé pour en faire de véritables jeux. C’est à travers ses jeux qu’il fait rentrer les mathématiques, non seulement dans la presse spécialisée, puisque son journal est orienté sciences, mais dans le grand public, par ses ouvrages, ses inventions, ses tours de magie, ses créations ludiques de toutes sortes. Il réussit le tour de force – tout autodidacte en mathématiques qu’il fut – à partir d’une idée banale de jeu, d’y introduire des notions de mathématiques, dont s’emparent parfois des mathématiciens célèbres, et de faire fructifier leurs idées pour les réintroduire dans ses jeux.
« L’un des plaisirs d’écrire dans ces colonnes, disait-il, était de me voir introduit auprès tant de grands mathématiciens, ce que bien sûr je n’étais pas. Leurs contributions à mes articles étaient bien supérieures à ce que je pouvais écrire et elles ont été l’une des raisons majeures de la popularité de mes chroniques. Le secret de ce succès était en fait le résultat direct de mon ignorance. […] Il me faut, pour mes articles, m’efforcer de comprendre ce que j’écris et cela m’aide à écrire de manière que les autres puissent comprendre. »
Par son talent de vulgarisateur, Gardner a non seulement popularisé des jeux mathématiques, permettant à un large public de connaître et manipuler des inventions de mathématiciens comme le jeu de la vie de John Conway, les pavages quasi-périodiques de Roger Penrose ou le jeu de Hex de Piet Hein, d’utiliser de « vrais » arguments de mathématiques, mais encore su rendre aimables les mathématiques elles-mêmes et les faire sortir du cadre strict où elles étaient enfermées.

Comment fabriquer
un tétraèdre avec un dollar
(La Recherche, juin 1996).
Parmi les billets de banque, seul le dollar,
par ses dimensions,
se prête au jeu.
La voie était tracée. La plupart des revues scientifiques françaises ont ouvert des pages « mathématiques pour le plaisir » : Science et Vie avec les colonnes « Jeux et paradoxes » de Pierre Berloquin (voir FOCUS "Le lent renouveau d'après-guerre") entre1964 et 1986, Pour la Science avec la rubrique « Logique et calcul » que tient Jean-Paul Delahaye depuis 1991, La Recherche avec la rubrique « Chercher, jouer, trouver » d’Élisabeth Busser et Gilles Cohen (entre 1995 et 2009), qui renaît depuis peu un mois sur deux en alternance avec « Enigmes, logique et mathématiques » de Pierre Berloquin, sans oublier Tangente avec les pages de jeux mathématiques de Michel Criton.

Martin Gardner utilise un argument de parité pour prouver qu’il est impossible de mettre ces trois verres à l’endroit en n’en retournant que deux simultanément.
Les enfants mathématiciens
Les revues grand public comme Jeux et Stratégies, entre 1980 et 1990, devenue par la suite Tangente Jeux et Stratégies, ou Jouer Jeux Mathématiques, se consacraient aux jeux mathématiques ; rares sont les revues scientifiques qui n’offrent pas, au moins une fois par an, des numéros hors-séries dédiés au sujet.
Les mathématiques ludiques sont même sorties du cadre des revues scientifiques pour gagner certains journaux ou périodiques grand public : on connaît par exemple la rubrique d’énigmes mathématiques proposée par Marie Berrondo-Agrell, sous le pseudonyme Euréka, dans Valeurs actuelles. Madame Figaro offre sur un blog (laclassedemmefigaro.eklablog.com) de petits problèmes plus spécialement dédiés à la culture mathématique des plus jeunes, sous le titre « La classe de Madame Figaro ». Le quotidien Libération a tenté le pari lors de la dernière Semaine des maths en publiant chaque jour un problème extrait du livre d’Alex Bellos, le Cercle des problèmes incongrus, mais le plus constant dans l’aventure mathématique est le quotidien Le Monde, d’abord avec les jeux de Pierre Berloquin de 1973 à 1984 (voir en encadré), puis avec la rubrique hebdomadaire « Affaire de logique », que tiennent Élisabeth Busser et Gilles Cohen tous les mercredis depuis 1997, rejoints depuis 2017 par Jean-Louis Legrand.
Les jeux mathématiques se sont donc largement répandus, beaucoup grâce à la presse, suscitant moins de méfiance ou de réticence dans le public, même chez les plus jeunes, ce phénomène rendant encore plus vraie la phrase de Martin Gardner « le jeu rend les enfants mathématiciens et les mathématiciens enfants ».
Lire la suite