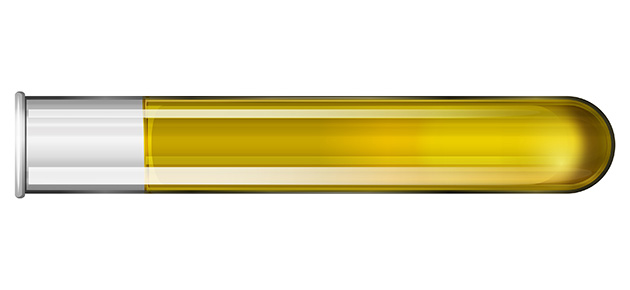
Lorsqu'un médecin suspecte une maladie chez un de ses patients et que l'examen de laboratoire ou le test clinique qu'il a prescrit à cet effet s'avère « positif », cela ne signifie pas nécessairement que le patient souffre de la maladie. Tout le monde connaît la notion de « faux positif ». Il revient donc au médecin d'évaluer correctement, sur la base de la positivité du test et d'autres informations disponibles, les chances (ou la probabilité) du patient d'être atteint de la maladie suspectée.
Un peu de théorie
Une illustration pratique sera le dosage sanguin de la glycémie (taux de sucre) en vue d'un éventuel diagnostic du diabète, maladie en pleine expansion dont on connaît les ravages sur la santé. Mais il faut rappeler d'abord quelques éléments théoriques récurrents sur la modélisation de ce type de situations.
On note respectivement M, M, T et T les événements suivants :
M : « on est en présence de la maladie suspectée »,
T : « le test prescrit est positif »,
La probabilité qui préoccupe le médecin au premier chef est celle d'être en présence de la maladie chez un sujet dont le test prescrit est « positif », soit la probabilité conditionnelle P (M | T).
En utilisant une formule connue relative aux probabilités conditionnelles (voir l'encadré), on peut écrire :
C'est le théorème de Bayes qu'on a l'habitude, en médecine, de présenter sous une forme un peu différente en introduisant les quelques notations et définitions suivantes :
• la « sensibilité », notée SE, du test T pour la maladie M est la probabilité P (T | M) de trouver le test positif chez les sujets atteints de la maladie ;
• la « spécificité », notée SP, du test T pour la maladie M est la probabilité
• la « prévalence », notée p, de la maladie M est la probabilité P (M) ; c'est la fréquence de la maladie M dans la population à laquelle appartient le patient ; cela peut être aussi la probabilité a priori (subjective) du médecin que son patient soit atteint de la maladie suspectée avant que le test T ne soit effectué ;
• la « valeur prédictive positive », en abrégé VPP, est la probabilité P (M | T) d'avoir la maladie M sachant que le test T est positif.
Avec ces notations, le théorème de Bayes peut encore s'écrire :
Un exemple concret : le test de Folin-Wu
 Dans le cadre du dosage sanguin de la glycémie par la méthode de Folin-Wu (test T) pour diagnostiquer le diabète (maladie M). Il est admis que :
Dans le cadre du dosage sanguin de la glycémie par la méthode de Folin-Wu (test T) pour diagnostiquer le diabète (maladie M). Il est admis que :
• si la glycémie observée une heure après le repas est supérieure ou égale à 150 mg / ml, le test est positif ;
• si elle est inférieure à 150 mg / ml, le test est négatif.
Ce test a été appliqué chez 510 sujets non diabétiques et 70 patients diabétiques. Les résultats observés sont repris dans ce tableau :
|
Test de |
Non |
Diabétiques (M) |
Total |
|
Négatif (T) |
461 |
14 |
475 |
|
Positif (T) |
49 |
56 |
105 |
|
Total |
510 |
70 |
580 |
À partir de ces données, on calcule la spécificité et la sensibilité du test de Folin-Wu.
Supposons que la prévalence du diabète soit de 6 %, d'où p = 0,06.
La valeur prédictive positive du test est dès lors donnée par :
On conclut alors que la probabilité d'être diabétique en présence d'un test de Folin-Wu positif est de 34,7 %.
Si, sur base de l'histoire familiale du patient et d'autres considérations médicales, le médecin estime que la probabilité a priori du diabète chez ce patient est de 20 %, en utilisant le théorème de Bayes, la probabilité d'être diabétique en présence d'un test positif s'élève à 67,6 %, soit le double de précédemment. En effet,
Ces deux exemples montrent le rôle important de la prévalence de la maladie dans l'application du théorème de Bayes. À la limite, si une maladie est très rare (prévalence extrêmement faible), le test diagnostique peut être inutile en dépit d'une bonne sensibilité et d'une bonne spécificité.
Une remarque : le théorème de Bayes appliqué au diagnostic (différentiel) de plusieurs maladies M1, M2, …, Mk permet de calculer, en présence d'un test T positif, la VPP pour chacune des maladies et donc de privilégier la maladie pour laquelle la VPP est la plus grande.
Lire la suite