
Gauquelin, la démarche scientifique et l'effet Mars
 Des arguments astronomiques et astrophysiques, comme le phénomène de précession des équinoxes ou simplement la vitesse de la terre qui implique que, d'une année sur l'autre, elle est loin d'occuper, à la même date, la même position dans l'univers, suffisent à montrer les incohérences qui fondent l'astrologie. Pourtant, certains ont tenté de confronter ses prédictions à des démarches rigoureuses.
Des arguments astronomiques et astrophysiques, comme le phénomène de précession des équinoxes ou simplement la vitesse de la terre qui implique que, d'une année sur l'autre, elle est loin d'occuper, à la même date, la même position dans l'univers, suffisent à montrer les incohérences qui fondent l'astrologie. Pourtant, certains ont tenté de confronter ses prédictions à des démarches rigoureuses.
C'est, dans les années 50, le cas du psychologue Michel Gauquelin, qui se livre à des études statistiques sur l'influence des astres sur les destinées. Son étude porte en particulier sur la position de Mars dans le thème astral de sportifs connus. Il semble déceler une anomalie statistique : le fameux effet Mars. Gauquelin, s'adresse alors au Comité belge pour l'investigation scientifique des phénomènes dits paranormaux qui « conteste la validité des diverses formules adoptées (...) pour le calcul des fréquences ». Les travaux de Gauquelin sont, malgré tout, toujours cités comme preuve scientifique par les astrologues*.
Pourquoi croit-on à l'astrologie ?
Si le point de départ est un désir légitime de connaitre des réponses à des phénomènes qui semblent mystérieux pour l'humain, la somme de connaissances scientifiques actuellement disponibles devrait suffire à faire disparaitre toute velléité astrologique. Or ce n'est guère le cas.
D'où vient alors cette fascination pour ce qui est dénoncé depuis longtemps comme une pseudo-science ? La réponse est à chercher en... psychologie. Il se trouve en premier lieu que le cerveau humain fonctionne principalement par analogie. C'est justement l'un des fondements de l'astrologie : Mars représente la force, donc l'influence de la planète Mars a une incidence sur les performances sportives ; concernant les relations amoureuses, c'est la position de Venus qui est déterminante etc. L'argument est aussi sérieux que de soutenir que manger des noix rend intelligent parce qu'elles ont la forme d'un cerveau.
Ensuite, il est beaucoup plus confortable de croire à ce genre de relations simplistes plutôt que de faire l'effort d'apprendre quelques notions, non évidentes, d'astronomie pour les remettre en question. Autre argument en faveur de l'astrologie : si la science est généraliste et difficile d'accès, l'astrologie, en revanche, traite, de manière simple, d'un sujet nettement plus intéressant : nous-mêmes.
La zététique
Que les croyances au paranormal soient installées par confort intellectuel ou par divers escrocs dans un but commercial, l'instruction et le développement de la culture scientifique restent la meilleure arme pour résister à la pression des gourous. Le laboratoire de zététique a été créé en 1998 à la faculté des sciences de Nice par le physicien Henri Broch (et fermé en 2014 lorsque ce dernier a pris sa retraite). Si la zététique ne dénie pas le droit de rêver, elle milite pour donner les outils qui permettent de différencier les croyances de la réalité scientifique. Science du doute, la zététique se définit comme une démarche intellectuelle s'appuyant sur l'investigation scientifique. Son champ d'étude concerne les théories « scientifiquement réfutables », parmi lesquelles les phénomènes dits « paranormaux » et autres pseudo-sciences. Son principe est de chercher l'origine des croyances dans ces phénomènes et de proposer à un large public qui serait tenté par elles des expériences de réfutation ainsi que des explications alternatives se basant sur des théories scientifiques.
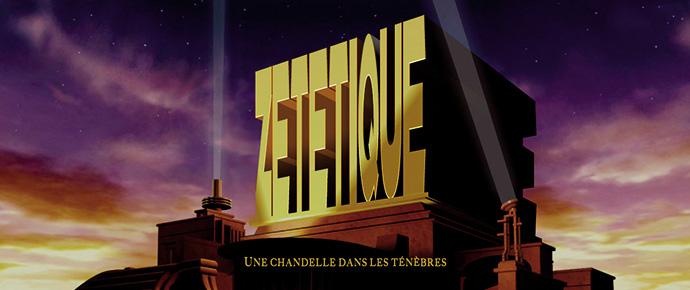
Des biais cognitifs induits par les pseudo-sciences proviennent en effet de manipulations langagières : ainsi, une question du type « Comment le Père Noël fait-il pour entrer par la cheminée ? » présuppose son existence. Le mouvement de zététique incite donc à la vigilance.
* Michel Gauquelin s'est suicidé le 20 mai 1991 en donnant instruction au psychologue Suitbert Ertel de détruire l'ensemble des données de ses études.
Lire la suite gratuitement